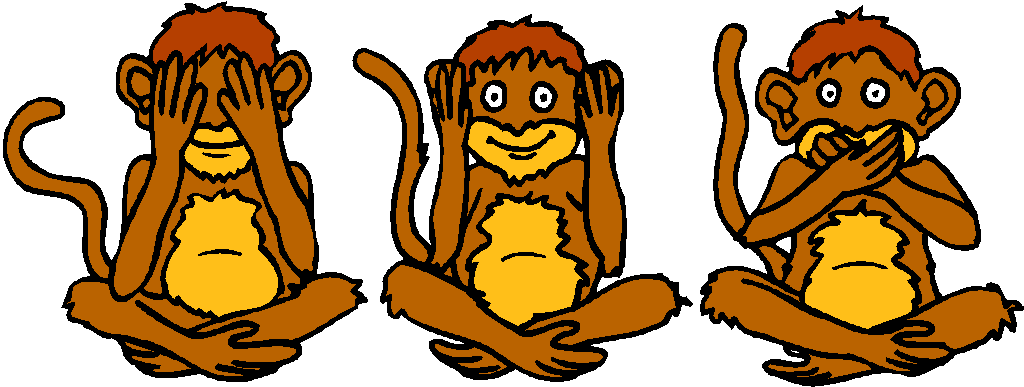Après Eric Berne, l’AT continue
Au sein de cette « A.T. classique », les différentes approches sont considérées comme complémentaires et susceptibles d’être combinées en dépit de leur divergences.
José Grégoire – Les orientations récentes de l’analyse transactionnelle
Une école de pensée désigne un ensemble de personnes qui partage des opinions semblables ou un point de vue similaire en philosophie.
Eric Berne a fait de l’AT une discipline ouverte, dans la mesure où le processus reste éthique et contribue à guérir le patient. Nombre de transactionnalistes ont alors apporté leur singularité en contribuant à son développement.

Aujourd’hui encore, l’AT évolue. Chaque trimestre paraît la revue Actualités en analyse transactionnelle (AAT) en français, et le Transactional Analysis Journal (TAJ), en anglais, qui questionne les pratiques. Chaque analyste transactionnel peut y contribuer en écrivant des articles de fond qui contribueront au développement de l’AT. Les cinq écoles présentées ci-dessous sont extraites d’un article de J. Wilson & I. Karina, publié dans le Classique des ATT n°1.
Les écoles récentes en AT
Le monde évolue et l’AT aussi. Le premier cercle des proches d’Eric Berne ayant montré la voie, d’autres analystes transactionnels leur ont emboité le pas en intégrant leur pratique à la théorie. L’AT continue donc à se développer. José Grégoire, dans son livre Les orientations récentes de l’analyse transactionnelle, a recensé plusieurs écoles, à noter que tous ces théoriciens sont du champ Psychothérapie . Citons ici ces nouvelles écoles.
- L’analyse transactionnelle psychanalytique, de Carlo Moïso et Michele Novellino ;
- La psychothérapie intégrative, de Richard Erskine et Rebecca Trautmann ;
- L’analyse transactionnelle relationelle, de Charlotte Sills et Helena Hargaden ;
- L’approche corporelle relationnelle, de Bill Cornell ;
- L’analyse transactionnelle co-créative, de Graeme Summers et Keith Tudor ;
- L’approche narrativiste, de Jim et Barbara Allen.
Quel lien entre l'AT et d'autres approches psychothérapeutiques ?
On connaît l’attachement de Berne à la psychanalyse et à son fondateur Sigmund Freud. Jusqu’à la fin de sa vie Berne est resté un grand admirateur de Freud même si sa pratique l’a amené à développer l’AT, mettant ainsi de la distance avec la psychanalyse. Le divan est resté présent dans sa salle de consultation.
Les années 60 ont vu aussi se développer l’école de Palo Alto, à quelques kilomètres de Carmel. Eric Berne était l’ami de Grégory Bateson, le fondateur de l’école. Il était également l’ami de Fritz Perls, qui s’est aussi éloigné de la psychanalyse pour créer la Gestalt thérapie. Notons enfin plusieurs référence dans l’œuvre de Berne à Alfred Korzybski, inventeur de la sémantique générale, dont le but était de montrer l’influence du langage dans les comportements. Quelques années plus tard la PNL exploitera l’idée que la carte n’est pas le territoire.